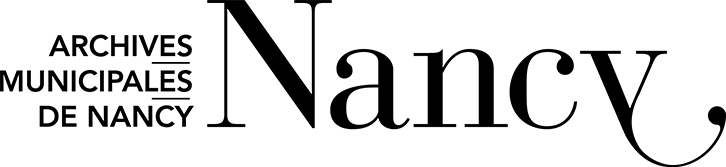LA MANUFACTURE DES TABACS
DÉNOMINATION
Manufacture des tabacs de Nancy
LOCALISATION
Grand Est, Meurthe et Moselle, 54000 ; Nancy ; 10 rue Baron Louis
AUTEUR(S)
GUTTON Antoine Barthélémy
DATATION
1864 : Début de la construction
1870 : Fin de la construction
1980 : Fermeture de la manufacture, devient une friche industrielle
1991 : Construction du complexe culturel
Étudiants : BEAUJOUR Kanèle - BECQ Clara
Enseignant : STEINMETZ Hugo
Depuis la vulgarisation de la consommation de tabac à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, l’État commence à développer un intérêt pour le produit et sa production. Fumer est un phénomène qui s’est très largement répandu tout au long du XVIIIe siècle, engendrant par la même occasion la diffusion du modèle architectural des manufactures.
La Lorraine, et tout particulièrement Nancy, connaît une expansion rapide et importante de la production de tabac grâce à l’organisation des usines ainsi que la qualité du sol du bord de la Meurthe, qui est propice pour planter cette denrée. On ne plante plus seulement le tabac, on construit dès lors des manufactures pour le préparer.
La construction de la manufacture, en deux temps, débute en 1864 pour s’achever en 1870. L’usine reste en activité durant une centaine d’années, avant d’être progressivement fermée jusqu’à devenir une friche industrielle en 1980. Protégé au titre de la législation sur les monuments historiques, l’ensemble de bâtiments fait néanmoins l’objet d’un vaste programme de réhabilitation dans les années 1980.
La manufacture des tabacs de Nancy devient alors, en 1991, un complexe culturel regroupant une bibliothèque, une médiathèque, le Théâtre de la Manufacture, le Conservatoire régional, le Pôle image et l‘ICN de Nancy ainsi que l’Institut européen de cinéma et d’audiovisuel. Préservée grâce au savoir-faire des architectes Patricia Henrion et Christian François, en charge de la reconversion du site, la Manufacture conserve son aspect d’origine encore aujourd’hui. L’ensemble de bâtiments, ordonnancé autour de trois cours, présente une combinaison de styles caractéristiques de l’époque industrielle et des éléments d’architecture contemporains. La cheminée de la cour centrale, la souche de la deuxième cheminée ainsi que la façade, toutes trois en briques rouges, ont été conservées, contrastant avec les passerelles en verre construites lors de la réhabilitation.
Retour
en haut
de page